Mémoires
7 octobre 2025
Mémoires
7 octobre 2025
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) appuie globalement les mesures législatives du projet de loi 112 visant à favoriser le commerce interprovincial. Elle remarque que le gouvernement souhaite par ce texte législatif, présenter un énoncé pour accroître les échanges commerciaux entre les provinces et la mobilité de la main-d’œuvre.
Selon l’institut C.D. Howe, l’élimination des barrières au commerce intérieur pourrait augmenter le niveau de vie au Canada et faire croître le PIB par habitant de 3,8 % à l’échelle nationale. Dans ce contexte, il serait d’autant plus important que le gouvernement du Québec travaille avec les autres provinces afin de faire tomber les barrières de manière cohérente.
L’importance de bien harmoniser la règlementation entre les provinces est reprise régulièrement dans les interventions de la FCCQ auprès de ses homologues du Canada, et des ordres de gouvernement qu’elle rencontre. Évidemment, cette attente est adressée également au gouvernement du Québec, à non seulement s’assurer de ne pas créer de la règlementation qui diffère trop des provinces canadiennes et du gouvernement fédéral, mais également de veiller à rendre l’encadrement règlementaire simple, transparent et prévisible.
Dans les objectifs présentés par le gouvernement lors du dépôt du projet de loi 112, celui-ci mentionnait entre autres l’objectif de réduire la lourdeur administrative dans nos échanges de marchandises, notamment pour les produits déjà certifiés ailleurs au Canada.
C’est un objectif retrouvé à l’article 2 du présent projet de loi, alors qu’il est mentionné que :
« tout produit fabriqué, préparé, cultivé, élevé, vendu ou utilisé à des fins commerciales dans une autre province ou dans un territoire du Canada en conformité avec les normes applicables dans cette province ou ce territoire peut être commercialisé, utilisé ou consommé au Québec sans autre exigence liée, selon le cas, à sa fabrication, à sa production, à sa préparation, à sa composition, à son classement, à sa teneur, à ses performances ou à la capacité de son contenant.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, sur recommandation du ministre responsable de l’application de la loi régissant les produits ou les exigences concernés, dans la mesure et aux conditions qu’il fixe :
1° exclure des produits ou des catégories de produits de l’application du premier alinéa;
2° déterminer les exigences visées au premier alinéa dont l’application est maintenue. »
La FCCQ demande au gouvernement du Québec de veiller à ce que les mécanismes d’exclusion et d’exception ne deviennent pas une norme, qui donnerait comme résultat, d’aller à l’encontre des objectifs visés par le projet de loi. En ce sens, les entreprises souhaiteraient avoir des précisions le plus rapidement possible, sur les produits ou catégories de produits qui se retrouveraient dans les projets de règlement, qui découleront de l’adoption du projet de loi 112.
Les prochaines exigences administratives et réglementaires liées aux échanges commerciaux entre les provinces devraient contribuer à réduire ou éliminer les obstacles, et non pas d’en créer de nouvelles qui seraient dommageables pour notre économie. Il s’agit d’un bel exemple où les gouvernements provinciaux devraient viser une reconnaissance mutuelle des produits utilisés à des fins commerciales et des exigences administratives demandées dans le cadre de la conception, de l’utilisation ou de la vente d’un produit. Cela permettrait que le processus d’exclusion et d’exception soit clair et transparent, plutôt que de devoir être confronté à des différences sur des produits ou des catégories de produits qui comportent des exclusions ou des exceptions, dans certaines provinces.
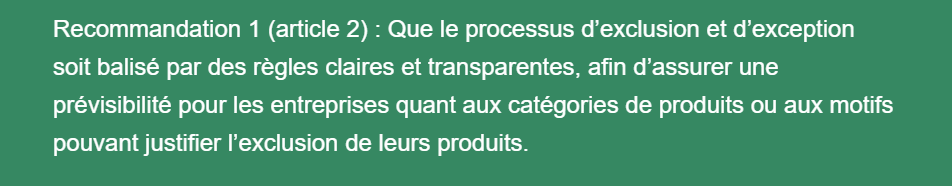
Dans ses relations canadiennes, les ministères québécois et des autres provinces, pourraient évaluer le potentiel d’harmonisation lors de l’élaboration ou de la révision d’une loi ou d’un règlement, afin de réduire et d’éliminer les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des investissements entre les provinces.
Dans le rapport du Groupe de travail Québec-Ontario sur l’amélioration du chapitre 3 « Coopération réglementaire », il était proposé une série de questions afin de guider les lignes directrices des ministères et des organismes publics et parapublics.
Parmi les exemples possibles, le Québec et les provinces pourraient envisager d’intégrer à leurs politiques réglementaires respectives une clause exigeant l’analyse de tout règlement susceptible d’avoir une incidence notable sur la libre circulation interprovinciale des personnes, des biens, des services ou des investissements. Dans un premier temps pour le Québec, de s’allier avec nos voisins ontariens et néo-brunswickois avec cet objectif commun, serait assurément un beau projet qui contribuerait à améliorer les échanges entre les provinces, et s’assurer d’une certaine prévisibilité et harmonisation des règles commerciales. Les questions suivantes pourraient guider les lignes directrices aux ministères :
Des pistes d’amélioration sont possibles du côté du fardeau règlementaire retrouvé dans nos échanges commerciaux avec les provinces. Dans le secteur du camionnage, plusieurs entreprises spécialisées dans le transport transfrontalier en direction des États-Unis, le volume des marchandises a diminué grandement au cours de la dernière année, étant donné l’incertitude économique causée par l’administration en place. 2 Malheureusement, on y retrouve encore des barrières importantes dans les opérations pour des entreprises qui doivent transporter des marchandises d’une province à l’autre.
Par exemple, pour transporter la même marchandise d’un bout à l’autre du Canada, des transporteurs doivent tout de même s’inscrire à répétition au sein de différents registres provinciaux. Les limites autorisées pour les charges ou la longueur des véhicules diffèrent entre le Québec et d’autres provinces, ce qui oblige ces entreprises de transport à adapter leurs flottes ou à limiter leurs trajets. Dans certaines provinces, on exige des inspections ou des permis supplémentaires pour les véhicules venant du Québec, ce qui ajoute des coûts et des retards. Un projet pilote visant l’harmonisation des règles avait été lancé par le gouvernement fédéral en septembre 2024. Initialement, le Québec ne faisait pas partie des provinces, contrairement à l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut.
Un autre exemple, cette fois dans le secteur agroalimentaire, les abattoirs sous réglementation provinciale ne peuvent vendre leurs produits dans les autres provinces. Au Québec, ils sont soumis à la Loi sur les produits alimentaires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, et les règlements touchant les abattoirs qui en découlent. Chaque province a son propre cadre législatif et ses inspections provinciales actuellement.
Dans le secteur des produits financiers, parmi les barrières interprovinciales à éviter, la double imposition de frais administratifs pour des transactions sur des produits dérivés et le manque de coordination entre les provinces (Ontario, Colombie-Britannique et bientôt le Québec). Il s’agit d’un exemple concret où il sera important de trouver une solution qui permettra d’éviter les frais redondants et de préserver la liquidité du marché. Le secteur financier souhaite également que la mobilité de la main-d’œuvre soit facilité pour des employés des institutions financières, comme des conseillers financiers ou des planificateurs financiers, entre autres. Nous aurons l’occasion de développer sur l’aspect de la mobilité de la main-d’œuvre, dans le prochain chapitre.
Également, dans le secteur des produits alcoolisés, si jamais le gouvernement du Québec a des discussions avec les autres provinces pour ouvrir davantage les marchés canadiens à nos produits alcoolisés québécois, il serait impératif que les accès de nos brasseurs, microbrasseries, distilleries au marché canadien soit réciproque.
Comme pour la circulation des marchandises, la Fédération des chambres de commerce du Québec appuie les dispositions du projet de loi visant la libre mobilité interprovinciale des travailleurs. Le projet de loi 112 marque un progrès significatif en stipulant d’emblée qu’un travailleur — sauf exception — ayant obtenu les certifications nécessaires dans sa province d’origine aura le droit de venir travailler au Québec sans devoir suivre de mise à niveau ou autre barrière.
En levant les entraves aux recrutements de travailleurs dans les autres provinces, le projet de loi 112 s’inscrit dans la réponse canadienne à la hausse des tarifs douaniers américains, mais il arrive à point nommé concernant la pénurie de main-d’œuvre qui sévit au Québec. Plus de 100 000 postes sont encore vacants. Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale estime que 1,4 million de postes à combler d’ici 2033 en raison des départs à la retraite et à la création d’emploi anticipé.
La FCCQ estime toutefois que le projet de loi introduit des dispositions permettant l’accumulation d’exceptions peu balisées et appliquées par règlement pouvant entraîner une imprévisibilité ou une lourdeur administrative qui n’est pas nécessaire.
Nous croyons que le projet de loi 112 pourrait être bonifié en limitant au maximum les délais imposés à un travailleur souhaitant exercer au Québec. Dans le cas des métiers et professions qui ne sont pas soumis au Code des professions, le gouvernement mandate les autorités de règlementation québécoises à délivrer le certificat de reconnaissance professionnelle selon un processus interne à établir.
La FCCQ croit que ce processus n’est pas nécessaire. Le principe guidant l’Accord de libre-échange canadien et le projet de loi 112, est la confiance envers les institutions et les autorités de règlementation des autres provinces. Celles-ci assurent déjà une règlementation des pratiques, des normes et des certifications des différents métiers et professions. Le Québec aurait tout à gagner à se libérer de la charge administrative et financière de délivrer la reconnaissance professionnelle. Nous devrions plutôt appliquer le principe de reconnaissance mutuelle automatique. La proposition actuelle occasionne des coûts et délais supplémentaires.
Ainsi, l’obligation de faire valider une reconnaissance professionnelle au Québec devrait se limiter aux seules situations exceptionnelles présentant un risque pour la santé ou la sécurité. Ces situations devraient être définies par règlement gouvernemental, sur la base des recommandations formulées par l’autorité de réglementation compétente.
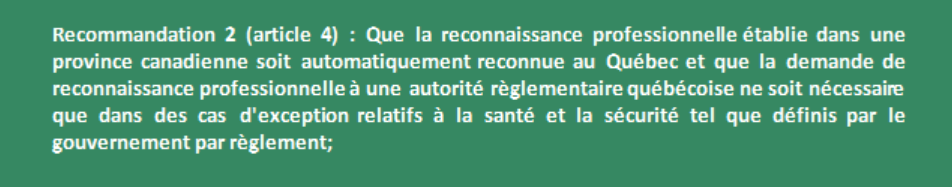
Advenant que cette recommandation ne soit pas retenue par le gouvernement ou pour encadrer les exceptions éventuelles, nous faisons d’autres recommandations visant à alléger le fardeau administratif et à accélérer les processus.
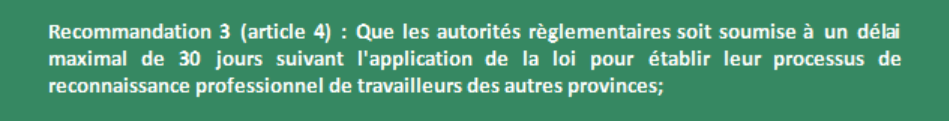
L’article 4 stipule également que les autorités de règlementation doivent établir un processus d’octroi de la reconnaissance professionnelle. Malheureusement, aucun délai n’est prévu quant à l’élaboration de ce processus. L’absence de délai maximal ouvre la porte à des délais inutiles, voire des abus, de la part des autorités règlementaires qui pourraient donner l’impression qu’ils retardent indument l’entrée de travailleurs dans le marché, en concurrence aux travailleurs québécois. La FCCQ croit que l’application du projet de loi 112 doit être rapide pour en récolter les bénéfices dès maintenant et ainsi limiter les effets de la hausse des tarifs douaniers qui se font sentir fortement, notamment dans le secteur manufacturier.
Considérant que les difficultés de recrutement de main-d’œuvre sont devenues un facteur invoqué du ralentissement de la production de passablement d’entreprise au Québec, il importe de s’assurer qu’un travailleur déjà recruté ne fasse pas les frais d’une bureaucratie trop lourde. Pour la FCCQ, il y a une différence importante entre un travailleur recruté par une entreprise, c’est-à-dire titulaire d’une offre d’emploi valide et un travailleur souhaitant simplement élargir son marché de l’emploi en se préparant à postuler au Québec.
Dans le premier cas de figure, la nécessité du travailleur pour l’entreprise est avérée. Il devrait alors être traité en priorité dans les autorités de règlementation pour qu’il puisse débuter son emploi le plus rapidement possible. Il faut éviter que ce travailleur attende indûment sa reconnaissance professionnelle derrière des candidats qui n’ont pas encore été embauchés.
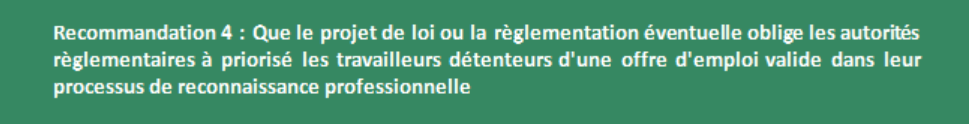
Pour ce faire, nous recommandons d’inclure dans la loi ou dans les règlements établissant les exceptions, l’obligation pour les autorités de règlementation de traiter les demandes de reconnaissance en priorité pour les travailleurs déjà embauchés.
Lors du dépôt du projet de loi, il a été clairement établi que l’industrie de la construction serait exclue, par règlement de l’application de ce projet de loi. L’actuel régime rendant impossible l’embauche de main-d’œuvre provenant d’autres provinces nuit à la productivité des entreprises.
Une importante entreprise du Québec nous soulignait que, même si situé à seulement 30 minutes de route de voiture de la frontière ontarienne, elle ne peut pas embaucher un plombier ontarien pour réparer sa machinerie. Cette situation l’oblige à attendre la disponibilité d’un plombier québécois très en demande situé à trois heures de route de l’entreprise. Cette situation entraîne des retards dans sa production et nuit à la dois à sa productivité et à sa compétitivité.
L’industrie de la construction au Québec est un secteur névralgique de l’économie qui souffre d’un manque de main-d’œuvre paralysant sa productivité. Il s’agit d’un des rares secteurs de l’économie où les postes vacants a augmenté plutôt que diminué entre le 2e trimestre de 2024 et le 2e trimestre de 2025 et s’établit maintenant à 9 000. Il faut aussi entrevoir que les grands projets, notamment ceux d’Hydro-Québec, nécessiteront des milliers de travailleurs régies par la Loi R-20.
Le Québec a franchi un pas vers une plus grande mobilité de la main-d’œuvre en construction avec le projet de loi 51 qui mandatait la Commission de la construction du Québec (CCQ) d’établir une procédure de reconnaissance de la formation et des diplômes délivrés hors du Québec ainsi que l’accroissement de la polyvalence des métiers de la construction. Ces deux objectifs poursuivis par le projet de loi 51 sont en droite ligne avec les principes qui sous-tendent le projet de loi 112. Néanmoins, pour le projet de loi 112 puisse s’appliquer au secteur de la construction, il sera nécessaire de revoir le nombre de métiers du secteur de la construction.
Considérant que la Commission de la construction du Québec a déjà eu des réflexions sérieuses sur la réduction du nombre de métier, nous proposons de leur octroyer de façon législative le mandat d’adopter un règlement faisant passer le nombre de métiers à un nombre entre cinq et sept d’ici les cinq prochaines années. Une telle obligation a d’ailleurs été utilisé afin d’imposer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) l’adoption d’un règlement en regard aux mécanismes de prévention et de participation des travailleurs dans un délai de deux ans. Nous avions d’ailleurs fait cette proposition lors des consultations sur le projet de loi 51.
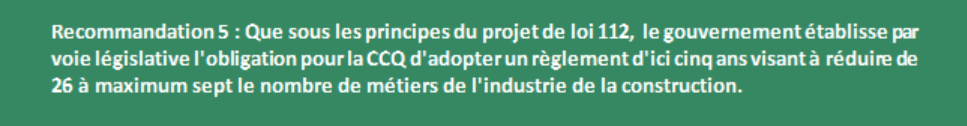
Cette réduction permettrait, à terme, d’appliquer le projet de loi 112 à l’industrie de la construction. Elle contribuerait à accroître significativement la productivité du secteur et pourrait, en partie, soulager les besoins de main-d’œuvre.
La FCCQ constate que le projet de loi est conçu pour conférer un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement du Québec dans l’évolution de la législation. Pas moins de 6 articles sur 14 (Les articles 2, 4, 5, 8, 9, 12) comportent des dispositions permettant au gouvernement de créer, par règlement, des cas d’exception, des processus ou des modalités.
Cette latitude que le gouvernement se donne représente un véritable risque pour les entreprises. Elle engendre une l’imprévisibilité qui peut freiner les investissements. Par exemple, un entrepreneur qui investirait dans l’exportation d’un bien dans le reste du Canada sous l’article 1 est à risque que le produit soit ultérieurement règlementé. On pourrait vivre la même chose du côté des embauches; les employeurs pourraient être à risque d’un changement règlementaire.
Un autre désavantage est qu’à terme, l’accumulation de règlements disparates pourrait complexifier les modalités du libre-échange canadien et ajouter une lourdeur administrative, qui est précisément le contraire de ce que cherche à faire le projet de loi. Les gouvernements successifs devront veiller que l’esprit de la présente loi demeure une priorité dans leur réglementation.
Le projet de loi 112 est un pas en avant important pour énoncer sur le plan législatif, le principe visant à encadrer la reconnaissance des produits vendus entre les provinces, et pour faciliter la mobilité de la main-d’œuvre. Néanmoins, les règlements qui découleront du texte législatif seront déterminants afin d’aller concrètement, vers des allégements de la règlementation dans la circulation entre les provinces. Pour arriver réellement à atteindre l’objectif de réduire au maximum les barrières entre les provinces, nous insistons sur la notion de clarté dans l’encadrement réglementaire, qui permettra aux entreprises concernées d’avoir des balises claires dans leurs relations commerciales avec le marché canadien, et de la prévisibilité.
Dans ses relations canadiennes, le gouvernement du Québec devra intensifier ses échanges avec les provinces et le gouvernement fédéral, afin de se doter d’objectifs communs clairs, pour éliminer les barrières au commerce interprovincial et à la mobilité de la main-d’œuvre qui nuisent à notre économie.
Dans le contexte économique actuel qui combine la relative fermeture du marché américain et une pénurie de main-d’œuvre aggravée par des politiques d’immigration plus restrictives, notamment au Programme des travailleurs étrangers temporaire, il convient d’assurer l’application rapide de ce projet de loi dès son adoption pour maximiser son effet sur l’économie.
À l’ère où notre économie fait face à une montée spectaculaire du protectionnisme américain, plus que jamais, les gouvernements des provinces doivent permettre les conditions pour alléger la réglementation visant à favoriser la libre circulation des biens et des personnes entre les différentes provinces. Pour ce faire, agir pour développer notre commerce intérieur en dérèglementant au maximum les barrières commerciales entre les provinces représente une solution importante.
Partager